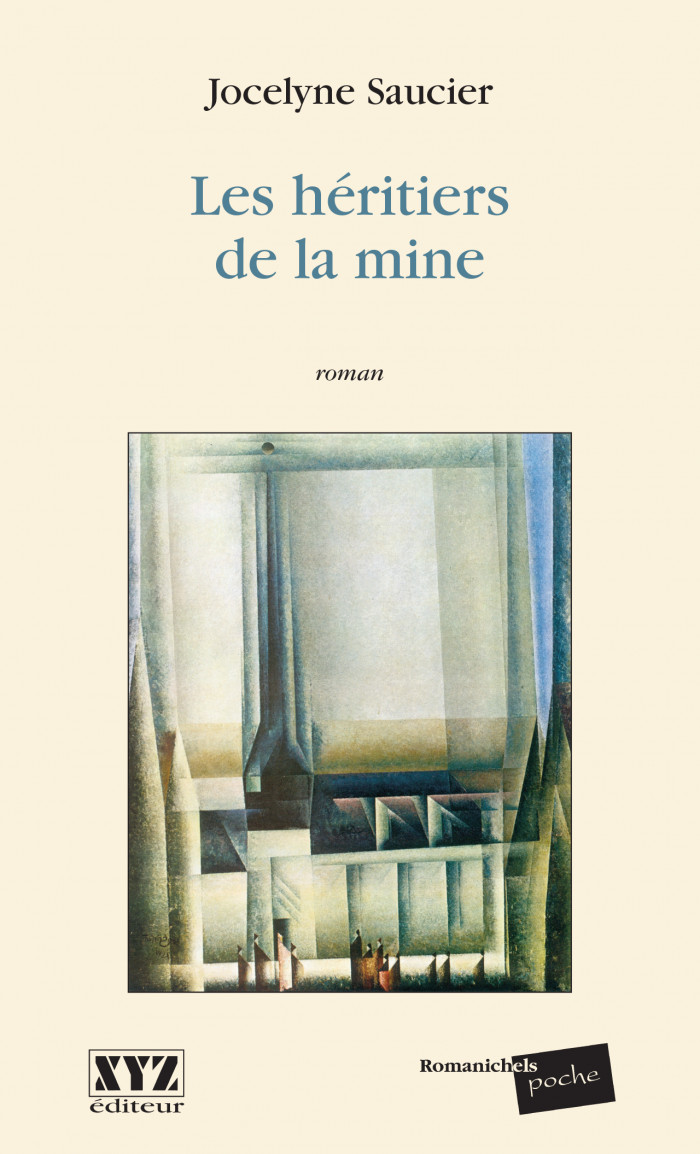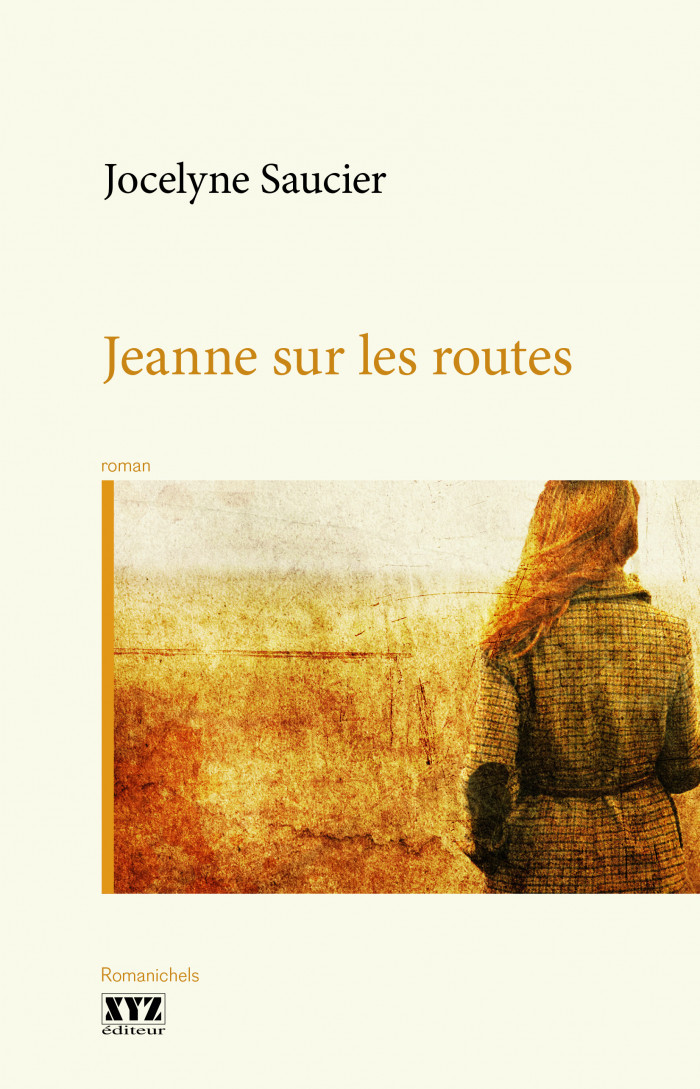Il y a maintenant un peu plus de vingt ans, l’écrivaine rouynorandienne Jocelyne Saucier entrait dans le paysage littéraire avec la publication de La vie comme une image, son premier roman. Paru en 1996 aux Éditions XYZ, le livre met en scène une vie familiale en apparence heureuse et douillette, rongée néanmoins par un indicible malheur. Depuis, Jocelyne Saucier a fait paraître Les héritiers de la mine (2000), Jeanne sur les routes (2006) et Il pleuvait des oiseaux (2011). Ce dernier, qui plonge le lecteur sur la piste d’un certain Boychuck, survivant du Grand feu de Matheson en 1916, jusqu’à l’ermitage tenu par Tom et Charlie, deux êtres résolument affranchis, fait présentement l’objet d’une adaptation cinématographique réalisée par Louise Archambault. Le film sortira le 13 septembre prochain, et met notamment en vedette Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte et Rémy Girard.
Chez elle, à Cléricy, l’écrivaine me raconte la surprise qui a accompagné le succès de son roman dès sa parution, et le tourbillon qui s’est ensuivi : « Ce roman-là, je ne pensais jamais que ça aurait ce succès-là […] Quand j’ai terminé le roman, je savais que c’était réussi, mais je me suis dit “Mon dieu Jocelyne, qu’est-ce que t’as écrit là, y’a personne qui va lire ça” ». Elle aurait même prévenu son éditeur qu’il aurait de la difficulté à vendre le livre, convaincue que son « histoire de p’tits vieux dans le fond d’un bois » n’intéresserait pas grand monde. Et pourtant, le livre a été à ce jour traduit en seize langues et a remporté de nombreux prix, dont le Prix des cinq continents de la francophonie (2011) et le Prix littéraire des collégiens (2012). Les propositions de films n’ont pas tardé non plus : au compte de trois, elles sont arrivées dans les mois suivant la parution du roman.
Encore aujourd’hui, l’écrivaine n’arrive pas à s’expliquer l’engouement du lectorat pour Il pleuvait des oiseaux. Il y en aurait sans doute long à dire sur les raisons d’un succès littéraire, mais je ne suis assurément pas en mesure de trancher. Néanmoins, je crois que certaines œuvres transportent avec elles une charge de vie si dense qu’un peu d’elles finit par se déposer en nous, et à nous de les porter ensuite. À cet égard, non seulement Il pleuvait des oiseaux, mais toute l’œuvre de Jocelyne Saucier m’apparait digne de mention.
D’abord, pour cette faculté qu’a l’autrice de construire les lieux et les temps de son œuvre de telle sorte qu’elle rappelle à la mémoire de larges pans d’une histoire pas si lointaine de l’Abitibi (et du nord de l’Ontario), ainsi que les splendeurs et misères qui tracent en partie la toile de fond de ce pays. Par exemple, Les héritiers de la mine présente l’histoire du Klondike abitibien, des villes champignons bâties autour de la découverte d’importants gisements miniers, de l’espoir et de sa chute. Norcoville, la ville du roman et le domaine des enfants Cardinal, « les Kings de Norco », est l’archétype même de la trajectoire suivie par plusieurs de ces villes minières nées sur la base d’une promesse trop fragile : « Les écoles illustrent bien ce qu’on avait espéré de Norco. Une ville minière qui accueillerait prospérité, longévité et le bonheur des petits enfants. Le rêve n’a pas duré et il a fallu faire avec la désillusion et ces trois grandes écoles de briques rouge ». Dans Jeanne sur les routes, c’est Rouyn la rouge, celle des « temps héroïques », des grèves des bûcherons et des Fros, vécus à travers les combats de Jeanne Corbin, militante communiste à qui Jocelyne Saucier redonne un souffle de vie inouï et qui marque à elle seule, semble-t-il, toutes les espérances d’une époque.
Et puis, il y a toutes ces vies mises en scène à l’aune desquelles on se prend à se regarder, à la fin. D’ailleurs, Jocelyne Saucier ne s’intéresse pas aux grands de ce monde, me dit-elle. Ce qui l’intéresse, ce sont les héros du quotidien, ceux que l’on ne connaît que peu ou pas du tout. Et de fait, dans son œuvre, ils sont partout — lire ou relire La vie comme une image, à ce propos. Mais tous ou presque sont marqués par quelque chose de commun : la quête d’un idéal. C’est LeFion, le plus jeune des 21 enfants Cardinal dans Les héritiers de la mine, porté par le récit familial glorieux — mais miné par le drame silencieux du décès de sa sœur Angèle — auquel il s’accroche et qui traque ses récits au détour de chaque conversation. C’est ce journaliste « devenu amoureux [de Jeanne Corbin] en même temps que communiste » et qui décide de consacrer sa vie à la lutte des travailleurs dans un monde qui lui a tourné le dos. C’est sa fille, narratrice de Jeanne sur les routes, pour qui « on a la vie qu’on a et la [sienne] s’est faite à rêver plus grand que la vie, plus grand que l’amour ». C’est Charlie, Tom et Boychuck terrés dans les bois, embrassant une liberté suprême, celle de se réserver le choix de leur vie comme de leur mort.
Mais plus encore, c’est sans doute la nature des questions posées, consciemment ou non, par l’œuvre de Jocelyne Saucier qui en font, il me semble, une œuvre qui s’incruste en nous et que l’on porte. C’est le cas du concept de bonheur, qui est omniprésent, mais tellement fragile, tellement prêt à s’échapper à tout moment qu’on le retient volontairement grâce à toutes sortes de récits, de mythes, et même parfois de mensonges. Comme s’il était intrinsèquement lié à un besoin de fiction. Besoin qui, lui, a peut-être, finalement, quelque chose à voir avec la vie elle-même…
DE RETOUR À CLÉRICY
Ainsi, Il pleuvait des oiseaux paraîtra en salles bientôt. Jocelyne Saucier dit avoir laissé l’entière liberté à l’équipe et n’avoir même pas demandé à être consultée pour l’écriture du scénario – l’équipe lui en a néanmoins fait parvenir différentes versions pour lui demander son avis, surtout sur des détails techniques. Pour l’écrivaine, le film est une autre création, pour la simple raison que cinéma et roman n’ont pas les mêmes besoins, le même langage. Et puis : « Le roman que j’ai écrit, ce n’est pas le même que tu as lu parce que le roman que tu as lu, tu l’as construit dans ton imaginaire […] Quand on me dit “je suis en train de lire votre roman”, je demande toujours “où est-ce que vous êtes rendus?” parce que j’aimerais lire dans sa tête, lire le roman qu’il y a dans sa tête ». À cet égard, le lecteur est privilégié dans la relation qu’il entretient avec le livre, dans la mesure où il peut lire celui que l’écrivaine avait dans sa tête, mais qu’elle n’a pas accès a priori à celui que le lecteur s’est imaginé dans la sienne. « Donc, conclut-elle, Louise Archambault, qui est la réalisatrice du film, je vais voir le livre qu’elle avait en tête. »